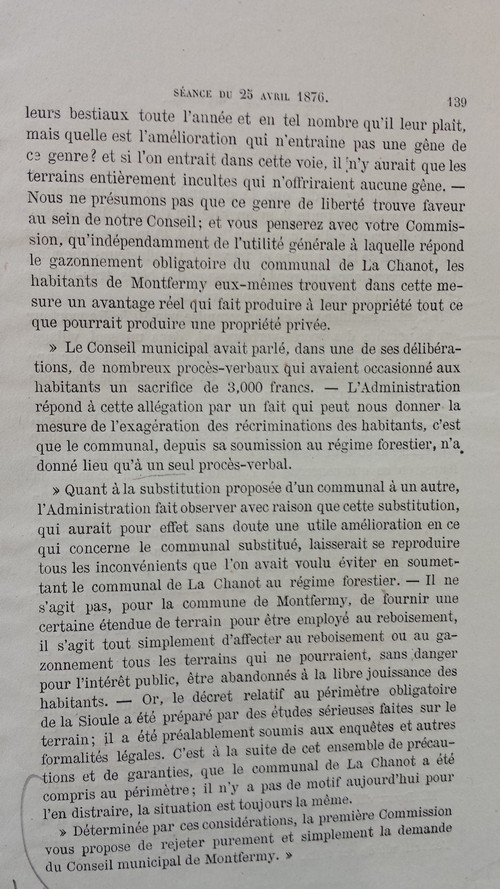MAUPASSANT ET L'AUVERGNE
Maupassant a écrit 6 romans et surtout 300 contes et nouvelles dans lesquels il peint le monde et la société en paysagiste, en portraitiste. L'écriture d'une étonnante clarté traduit une observation fine et implacable.
L'écrivain a beaucoup voyagé. Il a visité l'Algérie, la Tunisie, l'Italie, la Sicile, l'Angleterre...et l' Auvergne !
On apprend en lisant « Berte » publié en 1884 que Maupassant a fait connaissance avec l'Auvergne et Châtel-Guyon en 1876 :
« Mon vieil ami le docteur Bonnet m'avait souvent invité à passer quelque temps chez lui, à Riom. Je ne connaissais point l'Auvergne et je me décidai à aller voir vers le milieu de l'été de 1876. J'arrivai par le train du matin... Dès que j'eus avalé une tasse de café au lait, il fallut visiter la vieille cité. J'admirai la maison du pharmacien, et les autres maisons célèbres, toutes noires, mais jolies comme des bibelots, avec leurs façades de pierre sculptée. J'admirai la statue de la Vierge, patronne des bouchers … Maintenant je vous demande cinq minutes pour aller voir une malade, et je vous conduirai sur la colline de Châtel-Guyon, afin de vous montrer, avant le déjeuner, l'aspect général de la ville et toute la chaîne du Puy-de-Dôme...»
Maupassant et l'amour : « Cet homme constamment hanté par les femmes,si bien doué pour les attirer et les faire souffrir, ardent et fuyant, taquin,brutal et beau,où sont ses maîtresses ? Ne furent -elles donc toutes que des créatures d'un jour? Et pourquoi? »(1).
En 1877, à 27 ans il contracte la syphilis soignée avec les remèdes de l'époque : mercure et iodure de potassium. En outre il souffre de violentes migraines et de troubles visuels. Sa vie devient un véritable calvaire. Il abuse de drogue et d’éther. Son estomac lui provoque alors d'atroces douleurs. Espérant un soulagement, il fréquente les villes d'eaux. Ainsi il revient à Châtel-Guyon pour faire des cures en 1883, 1885 et 1886. Châtel lui doit l'écriture de son roman « Mont Oriol » qui relate la création de la station. Ses séjours furent l'occasion de découvrir la région.
On trouve une description de l'Auvergne dans « Humble drame » publié en 1883 :
« J'étais en Auvergne, errant à pied dans ces charmantes montagnes françaises, pas trop hautes, pas trop dures, intimes, familières. J'avais grimpé sur le Sancy et j'entrais dans une petite auberge, auprès d'une chapelle à pèlerinage qu'on nomme Notre-Dame-de-Vassivière, quand j'aperçus, déjeunant seule à la table du fond, une vieille femme, étrange et ridicule... Deux heures plus tard je gravissais les bords de l'entonnoir profond qui contient, dans un merveilleux et énorme trou de verdure, plein d'arbres, de broussailles, de rocs et de fleurs, le lac Pavin, si rond qu'il semble fait au compas, si clair et si bleu qu'on dirait un flot d'azur coulé du ciel, si charmant qu'on voudrait vivre dans une hutte, sur le versant du bois qui domine ce cratère où dort l'eau tranquille et froide. »
Dans « Petits voyages en Auvergne » , publiés en 1883, il fait encore, avec talent, une peinture de la région qu'il parcourt :
« L’Auvergne est la terre des malades. Tous ses volcans éteints semblent des chaudières fermées où chauffent encore, dans le ventre du sol, les eaux minérales de toute nature. De ces grandes marmites cachées partent des sources chaudes qui contiennent tous les médicaments propres à toutes les maladies.
Voici Vichy où l’on soigne les affections du foie, de la vessie, de l’estomac, des reins, de la gorge, de la rate, etc. ; voici Royat, où l’on guérit les maladies de la rate, de la gorge, des reins, de l’estomac, de la vessie, du foie, etc. Voici le Mont-Dore, La Bourboule, Saint-Nectaire, Châtel-Guyon, et tant d’autres lieux à filets de liquide minéralisé qui se vend en bains, en bouteilles et en douches ascendantes ou descendantes, selon les besoins de la clientèle.
La grande pharmacie souterraine d’Auvergne répond à toutes les exigences. Clermont-Ferrand, la capitale, s’étale dans une grande plaine enfermée par des montagnes. La ville est triste, un peu morte, et semble uniquement habitée par des paysans, tant on y rencontre de gens en blouse. L’Auvergnat manque d’élégance native. Il n’est pas fier comme l’Arabe, arrogant comme l’Espagnol, élégant et coloré comme l’Italien. Mais il n’a pas l’air non plus hâbleur comme le Méridional, ni rusé comme le Normand. Il semble honnête, simple et bon. On se sent ici chez un peuple de braves gens...
Moins hauts, le Puy de la Vache, le Puy-Minchier, le Puy du Pariou, le Puy de la Vachère forment à leur grand frère un état-major de pics. Et sur presque tous ces sommets se creusent d’immenses cuvettes, anciens cratères, aujourd’hui des lacs. Ceux qui n’ont point d’eau, comme le Pariou, servent de nids aux orages. Dans cet immense entonnoir, profond de cent mètres, les nuages s’amassent, s’entassent, et la foudre soudain gronde au fond de la montagne, comme s’il s’y livrait une bataille de tonnerres.
Si Clermont n’a point l’aspect d’une ville gaie, elle possède au moins un bois de Boulogne aussi élégant et aussi fréquenté que celui de Paris. C’est Royat...
Et, tout le long des chemins, on rencontre des attelages de vaches traînant des dômes de foin. Les deux bêtes vont d’un pas lent, dans les descentes et les montées rapides, tirant ou retenant la charge énorme. Un homme marche devant et règle leur pas avec une longue baguette dont il les touche par moments. Jamais il ne frappe, il semble surtout les guider par les mouvements du bâton, à la façon d’un chef d’orchestre. Il a le geste grave qui commande aux bêtes ; et il se retourne souvent pour indiquer ses volontés. On ne voit jamais de chevaux, sauf aux diligences ou aux voitures de louage, et la poussière des routes, quand il fait chaud et qu’elle s’envole sous les rafales, porte en elle une odeur sucrée qui rappelle un peu la vanille et qui fait songer aux étables.
Tout le pays aussi est parfumé par des arbres odorants. La vigne à peine défleurie exhale une odeur peu sensible mais exquise. Les châtaigniers, les acacias, les tilleuls, les sapins, les foins et les fleurs sauvages des fossés chargent l’air de senteurs légères et persistantes...
La route tourne dans un repli ombreux et voici Châtel-Guyon... »
« MES VINGT CINQ JOURS ». L'EXCURSION DU 7 AOUT 1885
La cure de l'été 1885 est relatée jour après jour dans « Mes vingt-cinq jours » nouvelle publiée le 25 août 1885 sous le pseudonyme de Maufrigneuse dans Gil Blas (2). Pour ce récit des 25 jours de cure, Maupassant introduit un deuxième narrateur, qui aurait fait une cure du 15 juillet au 8 août 1885.
« Je venais de prendre possession de ma chambre d'hôtel, case étroite, entre deux cloisons de papier qui laissent passer tous les bruits des voisins ; et je commençais à ranger dans l'armoire à glace mes vêtements et mon linge quand j'ouvris le tiroir qui se trouve au milieu de ce meuble. J'aperçus aussitôt un cahier de papier roulé. L'ayant déplié, je l'ouvris et je lus ce titre : Mes vingt-cinq jours. C'était le journal d'un baigneur, du dernier occupant de ma cabine, oublié là à l'heure du départ. Ces notes peuvent être de quelque intérêt pour les gens sages et bien portants qui ne quittent jamais leur demeure. C'est pour eux que je les transcris ici sans en changer une lettre... »
Maupassant est coutumier du fait (3). Le récit est bien celui du vécu de l'écrivain et non celui d'un curiste anonyme l'ayant précédé dans sa chambre d'hôtel! D'ailleurs la période du récit, du 15 juillet au 8 août devrait précéder celle du séjour de l'écrivain à Châtel-Guyon. Or, le 7 juillet il est à Paris et écrit à sa mère :
«….Je pars vendredi à une heure pour Étretat. Je n'y resterai que 3 jours, puis je reviens ici, et je me mettrai en route pour Châtel-Guyon le 18 juillet.
Décide-toi donc à y venir. Cela me ferait tant de plaisir de passer avec toi ces vingt-cinq jours. Si tu te décidais, je louerais une petite maison, ce que je ne ferai pas si je suis seul ... »
Et de Châtel il lui écrit un samedi d’août 1885 :
«Je viens de faire tant d'excursions que je n'ai pas trouvé une demi-heure pour t'écrire.J'ai vu Châteauneuf, le plus joli coin de l'Auvergne que je connaisse - vallée profonde au milieu de superbes rochers, - puis Pontgibaud, autre vallée moins jolie, puis, au-dessus de Volvic, le cratère de la Nachère, d'où l'on a un horizon extraordinaire sur la Limagne et sur le haut plateau d'où surgissent les puys. Ils sortent de ce plateau comme des clous énormes à tête tronquée.
Quant à moi, je compte partir mardi soir pour arriver jeudi à Étretat...»
Si l'on rapproche ces éléments d'un calendrier de l'année 1885 on peut conclure que Maupassant aurait séjourné à Châtel du samedi 18 juillet au mardi 11 août 1885, s'il était resté 25 jours. Cependant on dispose d'une lettre du 15 août à la comtesse Potocka et d'une lettre du 17 août à Mr Amic. Ces deux lettres ont été écrites à Châtel...(4) Maupassant a donc fait un séjour de plus de 25 jours.
En conséquence on en restera aux dates du texte !
Selon le récit, Maupassant a quitté Paris le 14 juillet avec le train de 1ère classe qui part à 9h10 et arrive à Riom à 17h38 (5) . Après une demi-heure de route il a pris possession de sa chambre au Splendid Hôtel.(6)
Le Splendid-Hôtel inauguré en juillet 1881 : « un grand hôtel silencieux où l'on dîne avec gravité, entre gens comme il faut et qui n'ont rien à se dire. »
Le 23 juillet il passe la journée à Royat. Le 25 juillet il se rend au Gour de Tazenat:
«Promenade en landau au lac de Tazenat. Partie exquise et inattendue, décidée en déjeunant. Départ brusque en sortant de table. Après une longue route dans les montagnes, nous apercevons soudain un admirable petit lac, tout rond, tout bleu, clair comme du verre, et gîté dans le fond d'un ancien cratère. Un côté de cette cuve immense est aride, l'autre boisé. Au milieu des arbres une maisonnette où dort un homme aimable et spirituel, un sage qui passe ses jours dans ce lieu virgilien. Il nous ouvre sa demeure...»
Le 2 août, il fait « une admirable promenade à Châteauneuf, station de rhumatisants où tout le monde boite. Rien de plus drôle que cette population de béquillards. »
L'Excursion du 7 août 1885
Le 7 août 1885, il fait une excursion de la journée en un lieu qui reste caché...et que nous allons essayer d'identifier.
«7 août. - Soixante-dix kilomètres en voiture dans la montagne. Je ne dirai pas le nom du pays par respect pour les femmes.
On m'avait indiqué cette excursion comme belle et rarement faite. Après quatre heures de chemin, j'arrive à un village assez joli, au bord d'une rivière, au milieu d'un admirable bois de noyer. Je n'avais pas encore vu en Auvergne une forêt de noyers aussi importante.
Elle constitue d'ailleurs toute la richesse du pays, car elle est plantée sur le communal. Ce communal, autrefois, n'était qu'une côte nue couverte de broussailles. Les autorités essayèrent en vain de le faire cultiver ; c'est à peine s'il servait à nourrir quelques moutons.
C'est aujourd'hui un superbe bois, grâce aux femmes, et il porte un nom bizarre : on le nomme "les Péchés de M. le curé".
Or, il faut dire que les femmes de la montagne ont la réputation d'être légères, plus légères que dans la plaine. Un garçon qui les rencontre leur doit au moins un baiser ; et s'il ne prend pas plus, il n'est qu'un sot. A penser juste, cette manière de voir est la seule logique et raisonnable. Du moment que la femme, qu'elle soit de la ville ou des champs, a pour mission naturelle de plaire à l'homme, l'homme doit toujours lui prouver qu'elle lui plaît. S'il s'abstient de toute démonstration, cela signifie donc qu'il la trouve laide ; c'est presque injurieux pour elle. Si j'étais femme je ne recevrais pas une seconde fois un homme qui ne m'aurait point manqué de respect à notre première rencontre, car j'estimerais qu'il a manqué d'égards pour ma beauté, pour mon charme, et pour ma qualité de femme.
Donc les garçons du village X... prouvaient souvent aux femmes du pays qu'ils les trouvaient de leur goût, et le curé ne pouvant parvenir à empêcher ces démonstrations aussi galantes que naturelles, résolut de les utiliser au profit de la prospérité générale. Il imposa donc comme pénitence à toute femme qui avait failli de planter un noyer sur le communal. Et l'on vit chaque nuit des lanternes errer comme des feux follets sur la colline, car les coupables ne tenaient guère à faire en plein jour leur pénitence.
En deux ans il n'y eut plus de place sur les terrains appartenant au village ; et on compte aujourd'hui plus de trois mille arbres magnifiques autour du clocher qui sonne les offices dans leur feuillage. Ce sont là les péchés de M. le curé.
Puisqu'on cherche tant les moyens de reboiser la France, l'administration des forêts ne pourrait-elle s'entendre avec le clergé pour employer le procédé si simple qu'inventa cet humble curé ?
7 août. - Traitement. »
A ce stade une considération importante s'impose. Maupassant se vantait de n'avoir inventé que deux de ses contes, tous les autres étant des histoires vraies arrangées par lui (7). Aussi peut-on admettre que Maupassant a bien fait cette excursion de la journée et qu'il a vu un assez joli village au bord d'une rivière et un admirable bois.
L'excursion du 7 juillet est une excursion de la journée qui lui permet même de respecter les contraintes de la cure puisqu'il note:« 7 aout -Traitement». Elle suppose un maximum d'environ six heures de transport en cabriolet ou landau . On notera que la précision « après quatre heures de chemin j'arrive ...» n'est pas vraisemblable. Elle traduit sans doute la pénibilité d'une partie du trajet effectuée sur des chemins plus ou moins carrossables.
L'emploi du temps de cette journée d'été peut être esquissé : lever à une heure décente, 7h00 par exemple, petit déjeuner, trois heures de route, visite de l'église et du village, rencontre avec le curé, le maire, quelques habitants... pique nique puis retour assez tôt pour se rendre à l'établissement de cure.
Le village est « assez joli au bord d'une rivière ». Nous avons le choix entre l'Allier et la Sioule. Mais Maupassant précise bien que l'excursion est en montagne. Ce sera donc la Sioule et les Combrailles ! Il est précisé que le Sioulet avec le village de Miremont ne peut être retenu car trop éloigné de Châtel pour faire l'objet, à l'époque,
d'une visite dans les conditions du récit.
A environ trois heures de voiture attelée soit trente à trente-cinq kilomètres de Châtel- Guyon nous pouvons recenser du sud au nord quatre villages au bord de la Sioule :
Pontgibault, Montfermy, Châteauneuf-les-Bains et Lisseuil.
Châteauneuf n'est pas le village recherché puisqu'il a fait l'objet d'une visite le 2 août.
Maupassant a été séduit par Châteauneuf « admirable promenade à Châteuneuf ». Il écrit à sa mère « J'ai vu Châteauneuf le plus joli coin de l'Auvergne que je connaisse... ».
Pontgibault a fait l'objet d'une visite puisqu'il écrit à sa mère en août 1885 : « j'ai vu...puis Pontgibault, autre vallée moins jolie... ». Or Pongibault ne figure pas dans la liste des visites et excursions effectuées pendant ces vingt-cinq jours de cure. Etait-il à Pontgibault le 7 août ? C'est peu probable car une excursion à ce village, à l'époque, ne peut pas être qualifiée de « rarement faite » . C'est un village important de plus de mille habitants avec un château et une porte depuis classés aux MH. De surcroît il est parfaitement accessible par une route qui figure parmi les routes nationales et départementales sur la carte Levasseur de 1852. C'est aujourd'hui la route départementale 943.
Lisseuil est le village le plus éloigné de Châtel. A l'époque il compte trois cents habitants. Son église romane au clocher-peigne à deux cloches renferme une statue du 13ème siècle. Il constitue une belle excursion. De Châtel , il faut emprunter la route
qualifiée de « grande communication » par Levasseur qui passe par Loubeyrat, Manzat et conduit à St Gervais puis Pionsat. C'est la route qui dessert également Châteauneuf. C'est aujourd'hui la route départementale 227. De Châteauneuf à Lisseuil il fallait emprunter un chemin mais seulement sur 5km. Est-il vraisemblable que Maupassant qui a déjà fait l'excursion de Châteauneuf le 2 août se rende à Lisseuil le 7 août en effectuant à nouveau six heures de route ?
Reste Montfermy...
MONTFERMY, UN VILLAGE AU BORD D'UNE RIVIÈRE

Le village de Montfermy
Une excursion belle et rarement faite
Maupasssant s'est-il rendu à Montfermy le 7 août 1885 ? « On m'avait indiqué cette excursion comme belle et rarement faite ». Indéniablement le site de Montfermy constitue un lieu de découverte exceptionnel, mais aujourd'hui encore il est moins fréquenté que le Puy de Dôme , le Pariou , le lac d'Aydat...
Le bourg, perché sur un relief, domine la Sioule dont le cours dessine de spectaculaires courbes. Une quinzaine de bâtiments proches de l'église abritent une population d'environ deux cents habitants soit la moitié qu'en fin du 19ème siècle.
L'excursion comporte plusieurs centres d'intérêt . Le cadre, bucolique à souhait, la Sioule fraîche et ombragée avec sa spectaculaire cascade toute proche, l'église romane du 14ème siècle....Les absides de cette église aux remarquables peintures murales sont classées MH depuis 1908. C'est le cas également d'une croix exceptionnelle dans le cimetière.
Voilà, semble t-il, le programme proposé à Maupassant le 7 août, programme justifiant pleinement 6 heures en voiture attelée sur des chemins plus ou moins ornières (8).
Aujourd'hui, pour se rendre en automobile de Châtel à Montfermy il faut rouler pendant 41' et parcourir 29 km (9). C'est la route la plus directe par Enval, Charbonnière les Varennes, Sauterre et Chapdes-Beaufort en empruntant les D15, D138, D50, D575 , D62 et D418 ! Les chemins qu'auraient suivis Maupassant sont les esquisses de ces départementales. Ils figurent sur la carte d'Etat-Major 1820-1866.
Trouver le communal
Nous sommes arrivés à Montfermy . Il faut maintenant trouver le « communal » sur lequel seraient plantés « 3000 noyers ». Maupassant n'a pas compté ces arbres ! Mais on peut admettre qu'il s'agit d'une plantation très importante sur un vaste terrain en pente puisqu'il est question de « côte ».
Le cadastre de Montfermy recense une centaine de parcelles communales soit environ 241 hectares . Une seule correspond à la description de Maupassant. Située au lieu dit « Les tanches et les genêts », elle est très vaste, adjacente au bourg et répertoriée sous le numéro 355. Elle borde le cours de la Sioule sur environ 1 km. On la traverse en arrivant de Chapdes-Beaufort par la route départementale 418.
Consultons le cadastre Napoléonien de Montfermy datant de 1827. Nous retrouvons cette même parcelle, numéro 99, appartenant « aux habitants de Montfermy » d'une surface considérable de 24,7530 hectares. Le point le plus élevé de la parcelle culmine à une centaine de mètres par rapport au niveau de la rivière. Nous sommes bien en présence d'une côte !
Cadastre Napoléonien : « Les tanches et les genêts », Parcelle 99 : 24,7530 ha
Cadastre Napoléonien : « Les tanches et les genêts », Parcelle 355 : 19,0182 ha
MONTFERMY ET LA FORÊT
Une forêt de 3000 arbres
Maupassant a vu un superbe bois de plus de 3000 arbres. Le communal de « Les tanches et les genêts » avec ses 25 ha peut-il être planté d'un nombre aussi important d'arbres? Oui sans aucun doute.
S'agissait-il de jeunes arbres ou de sujets centenaires ?
La carte de Cassini, bien qu'imprécise, ne laisse pas apparaître de forêt sur la parcelle. Sur le registre du cadastre napoléonien de 1827 il est mentionné que le communal est une « terre vague », et sur le plan, il est noté « pâture » au plus près des habitations. La forêt de 1885 est donc une forêt relativement récente voire une très jeune forêt. S'agit-il d'une forêt de noyers ?
Il semble que le noyer soit originaire de l'Asie du sud-est. En France, en général, les sujets appartiennent a des variétés de Juglans Regia.
La multiplication du noyer est opérée essentiellement par greffage mais elle est également possible par semi direct en pleine terre. Ce serait la méthode utilisée par ces dames dans le récit de Maupassant ! Le sujet devient adulte entre 25 et 40 ans et peut vivre jusqu'à 300 ans. En général on ne le trouve pas en altitude, à plus de 800m, car il craint le froid et notamment les gelées.
Le noyer est un arbre fruitier encore exploité comme tel essentiellement dans le Dauphiné. Mais il convient de souligner aussi que son bois était fort apprécié pour l'ébénisterie bourgeoise jusqu'au début du 20ème siècle, la réalisation de sabots, de crosses de fusils...
Le noyer est souvent isolé en plein champ ou en bordure de route. Il a un grand besoin de lumière et ne constitue pas de véritable forêt. En conséquence Maupassant a vu un vaste terrain avec un très grand nombre d'arbres, mais il est certain qu'il ne s'agissait pas de noyers.
Le communal et la forêt
Mais pourquoi Maupassant s’intéresse t-il à ce communal , sans doute spectaculaire à ses yeux ? Y a-t-il un lien particulier entre cette parcelle de Montfermy et la forêt ?
Strabon pensait que les deux tiers de la surface de la Gaule étaient couverts de forêts. Mais la carte de Cassini au 18ème siècle et les descriptions du début du 19ème siècle révèlent que le paysage de la France avait été profondément modifié au cours des siècles. La forêt occupait alors 14 % du territoire. Aujourd'hui elle représente 28 % du territoire national, 30 % du département du Puy-de-Dôme et 53% de la commune de Montfermy. L'Auvergne n'a pas échappé à ce déboisement, dont les origines sont multiples: accroissement des terres agricoles et des pâturages, besoins croissants en bois de chauffage et de construction...Il en résultait, notamment en montagne, des effets très négatifs dus à l'érosion des terrains en pente. Les eaux dévalaient sur les sols mis à nu et créaient désordres et sinistres dans les vallées.
Un certain nombre de personnalités se sont émus de cette situation. En Auvergne c'est le comte de MONTLOSIER qui a eu la réaction la plus vive. En 1827 dans sa célèbre lettre au Préfet il dénonce les déboisements et prescrit une réaction rapide des pouvoirs publics. Des actions significatives sont entreprises dans le Puy-de-Dôme mais la volonté de l'Etat ne se manifestera qu'avec la loi du 28 juillet 1860 sur le reboisement des montagnes et la loi du 8 juin 1864. Cette dernière permettra de substituer, dans certains cas, le gazonnement au reboisement afin de satisfaire les populations qui craignaient de voir installer des bois à la place des pâturages « afin de rendre les populations des montagnes sympathiques à l'opération de reboisement ... »(9).
Le département du Puy-de-Dôme qui n'avait pas attendu la loi de 1860 est en tête.
« Pour les reboisements des terrains communaux le département du Puy-de-Dôme occupe comme les années précédentes le premier rang quant à l'importance et à l'étendue des travaux...Ces beaux travaux qui ont mérité en 1862 d'être remarqués par S.M l'Empereur se poursuivent au milieu ds témoignages de la sympathie publique . »(10)
En effet en 1862 Napoléon III avait inauguré en personne l'exposition forestière de Clermont-Ferrand et remis la croix de la Légion d'Honneur à trois forestiers.
Les opérations de reboisement sont réalisées sous les deux formes, semis ou plantations, et la pépinière de Royat joue un rôle déterminant : « La pépinière de Royat établie dans la forêt du même nom et qui est fréquemment visitée avec un vif intérêt par les baigneur de l'établissement thermal. »(9). Les essences cultivées sont l’épicéa, le sapin, le pin noir d'Autriche, le pin d'Auvergne, le chêne, le châtaignier et le hêtre.
Le territoire de la commune de MONTFERMY n'avait pas échappé au déboisement d'autant plus qu'il était le siège d'ateliers de fabrication du charbon de bois qui alimentaient Clermont (11) . Il est fort possible que les besoins des exploitations proches de plomb argentifère aient également contribué au déboisement.
En application des lois de 1860 et 1862 et en vertu du décret impérial du 1er décembre 1865 les travaux de reboisement concernant les communaux du « périmètre obligatoire de la Sioule » ont été engagés sur 296 ha dans huit communes dont Montfermy au printemps 1867 . « Grâce à la température exceptionnelle qui a régné ce printemps, les semis et plantations ont eu lieu dans les meilleurs conditions. Ce résultat est d'autant plus satisfaisant que dans ces contrées les difficultés sont grandes par suite de la grande déclivité et de l'aridité des terrains. D'une part il est très important de convaincre , par des preuves irrécusables, une population routinière accessible aux plus ridicules préjugés et insouciante de l'avenir, qui a de tout temps considéré la propriété communale comme un bien dont elle peut abuser impunément sans entrave ni contrôle. Afin de concilier tous les intérêts, de donner satisfaction à certaines communes pour la privation de pâturage des indemnités ont été allouées ... »(12).
C'est à ce titre que MONFERMY recevra une indemnité de 128 francs pour l'année 1867. Cette indemnité correspondait-elle à la totale suppression des pâturages sur les communaux de Montfermy ? Il est fort probable qu'une partie de notre parcelle de 25 ha , la plus proche du bourg, soit restée sous forme de pâturage, à l'écart du reboisement. Encore fallait-il préserver des bestiaux le reboisement naissant. Cet impératif n'avait pas échappé au législateur. En conséquence le décret du 11 juillet 1882 pris en application de la loi du 4 avril 1882 sur la restauration et la conservation des terrains en montagne imposait aux maires et notamment au maire de Montfermy d'établir une réglementation du pâturage. Cette réglementation devait indiquer la nature, les limites, la superficie des terrains communaux concernés, les chemins par lesquels les troupeaux devaient passer, les diverses espèces de bestiaux, le nombre de têtes, la désignation des pâtres...(13).
En haut à droite, la crête et l'extrémité ouest du vaste communal situé au lieu dit « Les tanches et les genêts »
COMMENT MAUPASSANT PASSE DU FAIT AU CONTE
Maupassant, dés son arrivée à Montfermy par le chemin de Chapdes-Beaufort, remarque cette vaste côte plantée de plusieurs centaines voire de plusieurs milliers de jeunes arbres. Ils ont une dizaine de cm de diamètre et approchent les 8 à 10m de hauteur. Il visite l'église, se promène au bord de la Sioule, rencontre des habitants avec lesquels il engage la conversation. Il se présente au curé, au maire. Maupassant à Montfermy! Quel événement! Ces derniers parlent le patois mais peuvent aussi s'exprimer en français. Ils savent lire et connaissent le célèbre écrivain dont certains contes sont publiés dans le Moniteur du Puy-de-Dôme.
Maupassant interroge sur la côte et ses plantations. Très vite on lui parle du reboisement et encore du reboisement. On lui donne le chiffre de 3000 arbres...Certains esprits s’échauffent un peu. On lui dit qu'avec le reboisement voulu par l'Empereur on a touché gravement au droit de pâture. On lui parle des gardes forestiers qui délivrent trop de procès verbaux pour non respect du reboisement ou de l'engazonnement ...On trouvera en annexe le compte rendu de la séance du 25 avril 1876 du Conseil Général appelé à émettre un avis sur une demande de distraction du régime forestier formulée par la commune de Montfermy.(14) Les débats montrent bien l' état d'esprit des uns et des autres.
L'écrivain connaissait bien entendu l'ambition nationale de reboisement du pays. Il avait entendu parler des difficultés locales, des émeutes de 1864 dans les Alpes. Il savait que les populations locales voulaient disposer, à leur gré, des communaux Mais il ne s'attendait pas à ce que le reboisement soit le centre d’intérêt de son excursion du 7 août 1885 !
Comment relater cette journée ? A coup sûr les lecteurs de Gil Blas ne seraient pas intéressés par le seul récit des difficultés d'application des lois sur le reboisement des montagnes !
L'effet final est trouvé :
« Puisqu'on cherche tant les moyens de reboiser la France, l'administration des forêts ne pourrait-elle pas s'entendre avec le clergé pour employer le procédé si simple qu'inventa cet humble curé? ».
Et c'est un conte, une fable qui va étayer cette conclusion. Maupassant s'appuie alors sur ce qu'il sait ou sur ce qu'il croit savoir des femmes en général.
« Du moment que la femme, qu'elle soit de la ville ou des champs, a pour mission naturelle de plaire à l'homme, l'homme doit toujours lui prouver qu'elle lui plaît. S'il s'abstient de toute démonstration, cela signifie donc qu'il la trouve laide; c'est presque injurieux pour elle. Si j'étais femme je ne recevrais pas une seconde fois un homme qui ne m'aurait point manqué de respect à notre première rencontre, car j'estimerais qu'il a manqué d'égards pour ma beauté, pour mon charme, et pour ma qualité de femme. »
Puis du général il passe au particulier, au local , après avoir souligné une différence notable entre les femmes de la montagne et celles de la plaine.
Analysons les points du récit qui, peut-être, ne relèvent pas de la seule imagination de l'auteur.
En premier lieu voyons cette réputation qu'auraient eu les femmes de la montagne. Elle est démentie par Montlosier dont le domaine de Recoleine n'est pas si éloigné :
« Du reste dans cette partie de montagnes, les mœurs étaient tellement pures que dans l'intervalle de plus d'un demi siècle, on ne pouvait citer qu'un seul exemple de mauvaise conduite de jeunes filles, pas un seul d'adultère .»(15).
Plus sérieusement y avait-il des différences significatives entre la population de la montagne et celle de la plaine ?
« Il y a en réalité de grandes différences entre les montagnards et les habitants de la plaine »;(16). « C'est un lieu commun chez tous ceux, mémorialistes, voyageurs ou hommes publics, qui ont traité de l'Auvergne pendant le dernier siècle de l'Ancien Régime, d'opposer les traits physiques et caractériels des populations de la Limagne à ceux des montagnards. » (17).
« La vigueur physique supérieure, le mordant et l'esprit d'entreprise plus développés, la plus grande longévité des populations auvergnates de la montagne...l'homme des montagnes bénéficie d'une alimentation plus variée et plus riche en éléments énergétiques et en protéines ; alors que son contemporain des plaines est chroniquement en proie à de telles carences... » (18).
Ainsi, oui, assurément il y avait des différences entre les physiques, les comportements...Les écrits, les témoignages, les études ne manquent pas.
En second lieu , essayons de répondre à la question : Pourquoi le curé de Montfermy faisait planter des noyers et uniquement des noyers ? Pourquoi pas des hêtres, des frênes, des chênes des pins ? ...
Le curé est un personnage très important comme dans tous les villages. Il sait lire et écrire. Il veille au bon ordre et aux bonnes mœurs. Mais celui de Montfermy, dans son confessionnal, est un original. Point de Pater et d'Ave comme pénitence!L'absolution après l'obligation de planter un noyer.
La noix est le symbole de l'intelligence à cause de la forme des ses cerneaux qui ressemblent au cerveau humain. Mais dans l'Antiquité à Rome, et plus récemment dans bien des régions d'Europe et notamment dans le Dauphiné la noix est associée à la célébration nuptiale, au mariage. Dans le Dauphiné on offre une noix aux jeunes mariés devant l'église. Ce présent symbolise l'attachement que chacun doit avoir pour l'autre comme les deux cerneaux liés ensemble dans la coquille. La forme de la noix figure la double polarité de l'être humain, féminin/masculin, représentée par les hémisphères droit et gauche. La noix symbolise l'harmonie de ces deux composantes.
Ajoutons que selon Pline la noix était, par son écorce, symbole de solidité dans le mariage et que selon Saint Augustin elle représentait le Christ.
Avec la symbolique attachée au noyer, à la noix, le curé de Montfermy rappelait l'obligation de vertu, de fidélité aux pécheresses !
Ainsi sur ces deux points essentiels, différence entre gens de la plaine et de la montagne d'une part, et choix du noyer d'autre part, le récit de Maupassant ne relève pas de sa seule imagination.
Comme à son habitude, Maupassant a t-il transformé en texte littéraire des éléments récoltés de-ci de-là auprès d'amis, de sa mère ? Ou, et ce n'est pas à exclure, l'essentiel de cette fiction, de cette légende, ne lui a t-il pas été fourni, autour d'un verre par ses interlocuteurs de Montfermy qui lui ont sans aucun doute offert un « canon» ?
En forme de conclusion
Donc le 7 août 1885 Maupassant a fait une excursion de la journée dans un petit village au bord d'une rivière et il a vu une vaste plantation d'arbres qui a suscité sa curiosité. Ce village est très probablement Montfermy.
La plantation remarquable que l'écrivain décrit est, semble t-il , celle réalisée quelques années auparavant sur le communal exceptionnel de 25 ha . Le thème du conte, de la fable , associé à cette excursion est sans aucun doute le reboisement en montagne, priorité et ambition nationales du 19ème siècle : « Puisqu'on cherche tant les moyens de reboiser la France ... ». Ce projet mené avec efficacité, détermination et succès par l'Administration des Forêts a perturbé les usages, la vie de bien des villages car il a souvent porté atteinte au droit de vaine pâture sur les communaux. Ce fut le cas à Montfermy.
Quant aux récit avec le curé, les femmes de la montagne... , il est de la plus haute fantaisie. Mais on retrouve là, une fois encore, le talent de Maupassant pour transformer une légende, une histoire, des éléments disparates en un texte littéraire structuré, précis, original.
Enfin il reste aux passionnés, aux chercheurs la recherche de l'attestation qui prouverait que ce beau communal s'est bien appelé il y a longtemps « les Péchés de M. le curé.»
Notes
- Paul Morand .1993, Vie de Maupassant
- Gil Blas est un quotidien qui parut de 1879 à 1940 . Il publia de 1881 à 1890 de nombreux contes de Maupassant
- Guy de Maupassant De l'anecdote au conte littéraire .Bernard P.R. Haezewindt 2004: « il est donc possible d'affirmer que dans ses contes et nouvelles Guy de Maupassant pratiquait une impersonnalité auctorielle par personnages interposés ».
- Selon Louis Forestier (Contes et nouvelles, Pléiade, tome II) il est à Châtel du 17 juillet aux environs du 17 août
- Voir « En wagon » paru le 24 mars 1885 dans Gil Blas : « ...le rapide de de huit heures, le nouveau rapide direct organisé depuis quelques jours seulement,sur la réclamation générale de tous les baigneurs de l'Auvergne » et Marche des trains , service d'été 1885
- D'après Robert A .Accart (Châtel-Guyon et Guy de Maupassant -1989 La France Prades) sa mère aurait répondu favorablement à l'invitation du 7 juillet et aurait accompagné son fils à Châtel pour un bref séjour à la villa « Les Bruyères » .C'est à son départ que Maupassant aurait rejoint le Splendid
- Guy de Maupassant . De l'anecdote au conte littéraire .Bernard P;R Haezewindt 2004 « Ce qui constitue l'originalité du travail d'auteur de Maupassant c'est sa façon de transformer la matière brute de l'histoire drôle racontée par une tierce personne en un texte littéraire qui porte un cachet unique »
- La vie et l’œuvre de Guy de Maupassant . Maynial 1907 :« Il fuyait les terres trop admirées, trop décrites, trop visitées des touristes et recherchait en France même , quelques pays plus discret, où il n'avait d'autre guide que sa fantaisie, la Bretagne,la Corse ou l'Auvergne. »
- Calcul par le site web Via Michelin
- Rapport de H.Vicaire Directeur Général de l'Administration des Forêts 1864
- La vie rurale en Basse Auvergne au XVIIIème de Poitrineau 1965
- Revue des Eaux et Forêts 1868.de Roquefeuille
- Commentaires de la loi du 4/04/1882 sur la restauration et la conservation des terrains en montagne par Tetrean 1883
- Archives Nationales F/10/6235
- Montlosier /Un gentilhomme campagnard avant la révolution
- L'Auvergne de Louis Bréhier 1912
- La vie rurale en Basse Auvergne au XVIIIème.Abel Poitrineau 1965
- L'alimentation populaire en Auvergne au XVIIIème. Abel Poitrineau 1962
Annexes
Annexe 2 : Décret Impérial du 1er Décembre 1865
Annexe 3 : Conseil Général du Puy-de-Dôme, séance du 25 avril 1876. Réclamation de la commune de Montfermy